|
Gaston-François de WitteGaston-François de Witte
Gaston-François de Witte est un herpétologiste belge, né le à Anvers et mort le à Bruxelles. BiographieAppelé le plus souvent Gaston, il est le fils de Henry de Witte et de Jeanne della Faille de Leverghem et petit-fils du baron Jean de Witte, également homme de sciences. Il est membre de la famille de Witte (Anvers). Dès son enfance, il est passionné de sciences naturelles. Pendant sa scolarité chez les Bénédictins de l'Abbaye de Maredsous, Gaston-François de Witte fait la rencontre du zoologiste britannique George Albert Boulenger venu étudier, dans les collections de l’Abbaye, des fossiles du marbre de Denée. George Albert Boulenger se prend d’amitié pour lui, l’encourage à étudier les batraciens et les reptiles et rencontre ses parents[1].  Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Gaston-François de Witte trouve refuge chez Boulenger dans sa maison de Londres. Ce séjour lui permet d'apprendre l’anglais. Il travaille au British Museum (Natural History), où Boulenger l’initie aux techniques de préparation et à la gestion de collections zoologiques. Le , de Witte s’engage comme volontaire [1],[2]. Après la guerre, il étudie à l’Université libre de Bruxelles. Il y suit les cours d’Auguste Lameere et ceux de Jean Massart. Ces études le mène jusqu'au doctorat[2]. Dès 1920, il est nommé attaché à titre temporaire à la section des sciences naturelles du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren[1],[3], section qu’il dirige, toujours en intérimaire, en 1920-1921, en l’absence du titulaire, Henri Schouteden. En 1922, il se marie avec Marguerite del Marmol. De à , il fait, en partie en compagnie de H. Schouteden, un voyage d’exploration au Congo belge. Il ramène quelque 25 000 pièces, surtout des serpents et des poissons ainsi qu’un ensemble ethnographique et de nombreuses photographies, et laissa le tout au Musée du Congo belge. Nommé en 1927 à titre définitif, après le départ de Jean-Marie Derscheid, il devient en 1936 chef de la section de zoologie et d’entomologie. D’ à , il effectue une mission au Katanga, recueillant des spécimens zoologiques et botaniques, ainsi qu’une collection d'objets. D’ au , il explore le Parc national Albert (créé depuis moins de 10 ans au Congo, dans la région de Kivu)[2].  En 1937, il quitte le Musée du Congo et succède à Louis Giltay au Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique[1],[3]. Il en dirige, jusqu’à sa retraite, la section des vertébrés récents. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il reprend aussi des missions scientifiques en Afrique. De à , il remplit une mission d’information pour l’Institut des Parcs nationaux du Congo belge, visitant les parcs Albert, de la Garamba, de l’Upemba et de l'Akagera. Puis du au , et à nouveau du au , il dirige une mission au Parc national de l’Upemba. L'Institut royal des sciences naturelles de Belgique lui doit notamment un catalogue des collections sur fiches, une iconothèque, le suivi de l’exécution des cartes-vues éditées par l’Institut, l’installation de dioramas de batraciens et de reptiles dans leur milieu, (les premiers dioramas de l’Institut)[2]. À l'Institut des parcs nationaux du Congo belge, il devient responsable de la section scientifique, du au , et membre du Comité de direction, du au [2]. Fin 1951, il est libéré de ses fonctions de conservateur à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, et se consacre dès lors entièrement à ses recherches. Il étudie particulièrement la faune herpétologique du Congo belge. Il effectue également de nouvelles missions scientifiques en Afrique. Du au , il travaille ainsi à nouveau au Parc Albert, au Congo. Du au , il accompagne Victor van Straelen, président de l’Institut des Parcs nationaux du Congo belge, dans une mission d’inspection[2], dans un pays dont l'élite locale commence à envisager la décolonisation et l'indépendance[4]. Il a enrichi les collections africaines des musées belges par des centaines de milliers de spécimens d’amphibiens, d'insectes, de mammifères, d'oiseaux, de poissons, et de reptiles. Ces apports ont permis de décrire des genres nouveaux et des espèces animales nouvelles. À cela s’ajoutent plus de vingt mille clichés photographiques en noir ou en couleur, ainsi que des centaines d'objets ethnographiques et d’herbiers africains[2]. Titre de noblesseGaston-François de Witte est écuyer du Royaume de Belgique. Distinctions honorifiques
Il fut également nommé Honorary Foreign Member de l’American Society of Ichtyologists and Herpetologists (1946), Member of the International Trust for Zoological Nomenclature (1958), Honorary Life Member of the Herpetological African Association (1968). La Classe des Sciences de l’Académie royale de Belgique lui décerna le Prix Selys Longchamps (septième période: 1936-1941). Publications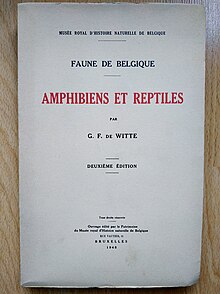 Liste non exhaustive
Notes et références
Voir aussiBibliographie
Liens externes
de Witte est l’abréviation habituelle de Gaston-François de Witte en zoologie. Consulter la liste des abréviations d'auteur en zoologie ou la liste des taxons zoologiques assignés à cet auteur par ZooBank Information related to Gaston-François de Witte |