|
Cahiers de littérature orale
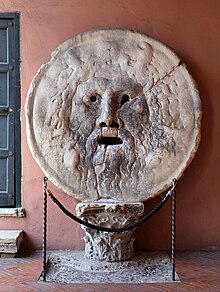 Les Cahiers de littérature orale, aussi abrégés CLO, est une revue scientifique française dédiée aux productions de l'oralité à travers le monde. Fondée en 1976 par Geneviève Calame-Griaule[1],[2] et une équipe de chercheurs, elle donne lieu à deux numéros par an. Chaque numéro explore un thème spécifique concernant les arts de la parole (verbal arts), dans toute leur diversité. Les CLO publient principalement, en français mais également en anglais, des articles scientifiques inédits (textes de réflexion, études et témoignages) et des comptes rendus d'ouvrages[2]. Depuis 2013, la revue est accessible en libre accès sur OpenEdition Journals, où tous les numéros à partir du 62 (2007) peuvent être consultés dans leur intégralité. Dès janvier 2020, le comité de rédaction des CLO rejoint le mouvement des Revues en lutte[3] et a participé aux différentes mobilisations pour la défense de la recherche publique, puis plus récemment à celui des sciences sociales contre l'extrême-droite[4]. Un numéro Hors-série a été publié en 2020 en guise de signe de lutte sous le titre « Oralités contestataires »[5]. PrésentationLes Cahiers de littérature orale sont nés de la volonté d'offrir davantage de visibilité et de légitimité à la « littérature orale de partout et de toujours »[6]. Les CLO étaient à l'origine la plateforme de travail du groupe « Oralité et domaines oraux (collecte de littérature orale, anthropologie de l’oralité, relation oral‑écrit) »[7] d'un centre de recherche qui réunissait des enseignants et chercheurs de l'INALCO, du CNRS et de l'EPHE, pour la plupart des anthropologues africanistes. Le groupe de recherche réunit alors Geneviève Calame-Griaule, Pierre Alexandre, Luc Bouquiaux, Jean Derive, Jacques Dournes et Michèle Dussutour-Hammer. Geneviève Calame-Griaule prend ensuite la direction du comité de rédaction qu’elle assumera jusqu’en 2011[8],[a]. La revue s'est définie comme « un lieu d'expression et de rencontre pour tous ceux qui travaillaient dans le domaine de l'oralité »[6] et n'a de cesse de réfléchir à ce qu'est la littérature orale et comment elle s'étudie : en prenant en compte la subjectivité de l'enquêteur et de l'enquêté, les contextes de réalisation de performances ou encore la pluridisciplinarité[9]. C'est la première revue, à l'échelle internationale, qui traite des productions de l'oralité, la revue américaine Oral Tradition n’ayant vu le jour que dix ans plus tard[10]. Liens institutionnelsLes Cahiers de littérature orale sont publiés par les Presses de l'INALCO[11]. La revue est rattachée au LLACAN[12] (CNRS et INALCO). Les CLO sont à leur commencement publiés par les P.O.F. (Publications Orientalistes de France), puis à partir du numéro 7 par l'INALCO et rejoignent ainsi les Publications Langues O’[13]. Dès le numéro 32, la revue est soutenue par le Centre de Recherche sur l'Oralité (C.R.O.), puis à partir du numéro 50-60 par le Centre d'Études et de Recherche sur les Littératures et les Oralités du Monde (C.E.R.L.O.M.). Depuis le numéro 70 et jusqu'à présent, la revue est soutenue par le LLACAN (CNRS). En mars 2024, les CLO sont devenus une revue d'association[14]. Objectifs éditoriauxDès leurs premières publications, les Cahiers de littérature orale se donnent comme objet d'étudier les arts de la parole dans toute leur diversité. Cette ouverture se manifeste non seulement sur le plan géographique et disciplinaire, mais aussi sur la variété des thématiques abordées. Une approche internationaleDepuis sa création, la revue des Cahiers de littérature orale s'est engagée à explorer la richesse des arts de la parole à l'échelle mondiale. Chaque numéro offre une plateforme pour des contributions étudiant diverses régions du globe, sur tous les continents. De plus, la revue s'intéresse à différentes époques, certains articles portant sur la Grèce ancienne et résonnant dans les milieux hellénistes[15],[16]. Une approche interdisciplinaireLa revue propose des perspectives provenant de diverses disciplines telles que l'anthropologie, l'ethnolinguistique et la littérature, ou encore plus récemment l'ethnocritique comme dans le n°93 (2023) à travers les contributions de Jean-Marie Privat[17] et Sophie Ménard[18]. La revue est un lieu de rencontre des disciplines et permet dans le même temps leur développement. Mettre en valeur les genres de la littérature oraleCertains numéros de la revue portent sur des genres spécifiques de la littérature orale :
Définition d'une méthodologie et de pratiquesDans son double numéro 63-64, la revue a pour but de « rendre compte de l’évolution des pratiques d’enquêtes en littérature orale et de s’interroger sur les recherches actuelles »[9]. Cela passe notamment par la prise en compte de la subjectivité de l'enquêteur et de l'enquêté, mais également du contexte de ce qu'est une performance. Cette définition méthodologique est surtout une exploration perpétuelle : dans son numéro consacré à Bob Dylan (n°94, 2024), la revue présente un nouvel outil, le code VOVA[19] qui propose une entextualisation du répertoire dylanien. IndexationLes Cahiers de littérature orale figurent sur la liste des revues référentes en anthropologie, ethnologie et folklore de l'HCERES en 2016, 2017 et 2021[20]. La revue est également référencée sur la base Mir@bel[21] et ERIHPLUS[22]. Numéros de la revueNuméros de la revue depuis 2007
62 . Le livre parle, 2007 63-64 . Pratiques d'enquêtes, 2008 65 . Autour de la performance, 2009/1 66 . Mémoire des CLO, 2009/2 67-68 . Quand l'art prend la parole, 2010 69 . Paroles de jeux, paroles de crise, 2011/1 70 . L'adresse indirecte ou la parole détournée, 2011/2 71 . Interlocutions périlleuses, 2012/1 72 . Contes à rendre, 2012/2 73-74 . D'un rythme à l'autre, 2013 75-76 . L'autre voix de la littérature, 2014 77-78 . Paroles publiques, paroles confidentielles, 2015 79 . Des vies extraordinaires : les territoires du récit, 2016/1 80 . Des vies extraordinaires : motifs héroïques et hagiographiques, 2016/2 81 . Le poète et l'inspiration, 2017/1 82 . Jouer avec le genre dans les arts de la parole, 2017/2 83 . Geneviève Calame-Griaule, 2018/1 84 . Le Récit généalogique, 2018/2 85 . Eclats de parole, 2019/1 86 . L'Heure du conte, 2019/2 Hors-Série . Oralités contestataires, 2020 87 . Ec(h)opoétiques, 2020/1 88 . Oralités enfantines et littératures, 2020/2 89-90 . Théâtre, performance et parole politique dans l'espace public, 2021 91-92 . Donner de la voix : slogans et chants contestataires, 2022 93 . Oralités de bonheur, oralités de malheur, 2023/1 94 . Bob Dylan, le pluriel des voix, 2023/2 95-96 . Poésies performatives : approches croisées, 2024Voir aussiNotes et références
Liens externes
Information related to Cahiers de littérature orale |
||||||||||||||||||||||||||||||||