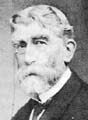|
Université libre de BruxellesUniversité libre de Bruxelles
L’Université libre de Bruxelles (ULB) est une université belge francophone implantée sur trois campus principaux (le Solbosch, la Plaine, Érasme) dans la région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à Charleroi (Gosselies). Fondée en 1834, elle est l'une des plus importantes universités belges et est régulièrement citée comme faisant partie des 200 meilleures universités mondiales[5],[6],[7]. HistoireOrigine L'Université libre de Bruxelles fut fondée le , dans une période qui suivit l'indépendance de la Belgique et qui connut la désorganisation de l'enseignement supérieur. Les trois universités d'État fondées à l'époque du royaume uni des Pays-Bas - Gand, Liège, Louvain - sont amputées de plusieurs facultés. Auguste Baron et Adolphe Quetelet avaient imaginé dès 1831 dans leur loge maçonnique Les amis philanthropes l'idée d'une université « libre ». La création, en 1834, de l'Université catholique de Malines, sous l'impulsion des évêques de Belgique, fut le détonateur qui poussa le monde libéral à réagir rapidement. Le juriste Pierre-Théodore Verhaegen, vénérable maître de la loge Les Amis philanthropes, lança en un appel à une souscription dans les milieux libéraux et dans les loges du Grand Orient de Belgique en vue de la création d'une université « libre » qui combattrait « l'intolérance et les préjugés » en répandant la philosophie des Lumières. On fit cependant remarquer à Verhaegen l'utopie de son projet, lui qui ne disposait ni de professeurs, ni de locaux, ni d'argent. C'était sans compter sur l'aide du bourgmestre de Bruxelles et franc-maçon, Nicolas-Jean Rouppe, qui trouva des locaux dans l'ancien palais de Charles-Alexandre de Lorraine, place du Musée. Verhaegen annexa à son projet l'École de médecine et trouva des enseignants parmi les hommes d'expérience du Musée des sciences et des lettres (d) « Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation ; nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens et de l'humanité...» XIXe siècle La première année universitaire pouvait commencer avec ses trente-huit professeurs et 96 étudiants. À l'origine, elle porte le nom d’université libre de Belgique et se compose de quatre facultés : philosophie et lettres, droit, sciences et médecine. À partir de 1842, elle changea de nom et devint l'université libre de Bruxelles. Jusqu'en 1847, l'université vécut des souscriptions lancées par le Grand Orient et diverses loges maçonniques du pays, dont celle des Amis philanthropes. Outre les difficultés financières, l'Église et l'État faisaient peser des menaces sur la jeune université libre de Bruxelles. La loi sur l'enseignement supérieur de 1835 supprimait l'Université d'État de Louvain, ce qui permit à l'Université catholique de Malines de s'installer dans la cité brabançonne où elle prit le nom d’Université catholique de Louvain et à se présenter petit à petit, en passant outre à plusieurs arrêts[8] et en déformant son histoire, comme étant l’héritière et la continuatrice légitime de l'ancienne Université de Louvain, ce qu'on peut toujours lire actuellement[9]. Il ne restait donc plus que deux universités de l'État - Gand et Liège. Quant aux évêques, ils avaient peine à admettre l'existence d'une université qui se proclamait autonome et qui échappait ainsi à leur contrôle. La presse catholique milita contre l'enseignement dispensé à Bruxelles. Verhaegen répondit à toutes les attaques par un discours académique retentissant où il proclama : « Partis de la liberté d'enseignement, nous réalisons la liberté dans l'enseignement. »  Surmontant ces querelles, l'université libre devint une institution reconnue. La population estudiantine était en progression et l'on put en 1842 déménager dans un nouveau bâtiment, le palais Granvelle sis rue des Sols et rue de l'Impératrice. En 1873, l'université ouvrit son école polytechnique où un enseignement pratique put être dispensé. En 1880, elle fut la première en Belgique à permettre aux femmes d'accéder aux cours et ce au sein de son Institut de pharmacie. Avant cela quelques-unes étaient allées étudier dans des universités étrangères, principalement en faculté de médecine. Il n'y avait pourtant, en Belgique, aucune restriction légale en ce qui concerne l'accès des femmes aux hautes études. Mais, traditionnellement, seuls les hommes entraient à l'université, et surtout, aucune école secondaire ne préparait les jeunes filles à de telles études. Le , un incendie détruisit l'aile gauche de l'édifice rue des Sols. La salle académique, la bibliothèque et une partie des collections minéralogiques disparurent dans les flammes. La reconstruction prit six ans. Le était, depuis l'ouverture, un jour de congé à l'université libre de Bruxelles mais ce n'est qu'en 1888, à l'initiative des étudiants, qu'on organisa les premières célébrations de la Saint-Verhaegen. En 1893, l'université libre de Bruxelles bénéficia d'un mécénat de grande envergure qui acheva le développement de la faculté de médecine : Ernest Solvay la dota d'un Institut de physiologie implanté au parc Léopold à Etterbeek (ces locaux sont actuellement occupés par le lycée Émile Jacqmain, une école secondaire très réputée) ; Raoul Warocqué, d'un Institut d'anatomie ; Alfred Solvay et quelques autres, d'un Institut d'hygiène et de bactériologie. Dès leur fondation, plusieurs instituts et facultés de l'université sont directement liés aux principales figures du capitalisme industriel belge à son apogée. Il n'est pas anodin que Solvay constitue une école de commerce (pour former les cadres nécessaires à sa multinationale), et un institut de physiologie (pour mesurer l'efficacité des ouvriers et contrôler leur rendement). En 1899, fut créée l'École des sciences politiques et sociales. Le XIXe siècle voit une intégration des Juifs à la société belge, en particulier grâce à l'Université qui accepte de nombreux étudiants et professeurs juifs. l'Université comptera également quatre recteurs juifs : Gottlieb Gluge, Martin Philippson, Adolphe Prins et Paul Errera[10],[11] La première crise des années 1890Affaire DwelshauversÀ l'origine issue d'un milieu certes anticlérical mais néanmoins catholique, ou au moins spiritualiste ou déiste, l'université verra au cours des dernières décennies du XIXe siècle le développement d'un courant farouchement athée ainsi que l'essor de la démarche scientifique positiviste chère à Auguste Comte, qui affirme le primat absolu de l'expérimentation et de la raison. Cette évolution ne se fit pas sans heurts. Ainsi, en 1890, la thèse de philosophie de Georges Dwelshauvers provoqua de vifs débats par ses positions athées alors que la majorité des professeurs de la faculté de philosophie et lettres étaient toujours déistes[12]. Affaire Élisée ReclusCes conflits entre doctrinaires et progressistes, puis entre libéraux et socialistes se traduiront également à l’université libre de Bruxelles par l’affaire Reclus. Élisée Reclus, géographe français anarchiste, avait été invité à donner cours à l’université libre de Bruxelles en 1892. En 1893, à la suite d'un attentat anarchiste, le conseil d’administration s’opposa à sa venue, désavouant ainsi le recteur Hector Denis, premier socialiste élu à ce poste. ConséquencesCela provoqua une scission et la création d’une université nouvelle (1894 - 1919) qui sera parfois même surnommée « Université bulgare », au vu du nombre d'étudiants bulgares qui y étudieront, et qui perdura jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. L'université libre modifia ses statuts et inscrit le le principe du Libre examen dans son premier article qui s'énoncera désormais comme suit: "L'Université Libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du libre examen. Celui-ci postule, en toute matière, le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement". Cercles étudiantsDans les années 1880, les étudiants se groupent en cercles facultaires[13]. Par la suite, on verra apparaître des cercles interfacultaires qui ne groupent pas les étudiants par leur appartenance à une même discipline, mais en fonction de leurs opinions, philosophiques, politiques, etc. Le Cercle du libre examen en est un exemple[14]. Début du XXe siècleL’Institut de sociologie fut fondé en 1902. L'année 1904 vit la création de l'École de commerce Solvay. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui entraîna la première interruption des cours de l'université, alors que Jules Bordet, professeur à l'université libre de Bruxelles se voit attribuer le prix Nobel de physiologie ou médecine (1919), on envisage de déménager à la suite de la croissance des besoins en espace et de la démolition du palais Granvelle du fait des travaux de la jonction Nord-Midi. Le choix se porte sur le plateau du Solbosch situé à la limite des faubourgs de l'époque. Les travaux débutent en 1921 par le bâtiment U inauguré en 1924. La construction du bâtiment A (qui n'est donc pas le bâtiment le plus ancien contrairement à une idée reçue) (1924-1928) est soutenue financièrement par la Belgian American Educational Foundation[15] (héritière de la Commission for Relief in Belgium (CRB)), une organisation américaine (présidée par Herbert Hoover) destinée à restaurer l'enseignement universitaire en Belgique meurtri par la guerre. Elle participe également avec la famille Tournay-Solvay au financement de la cité Héger ouverte en 1933. En 1939, est inauguré l'Institut de cancérologie Bordet, boulevard de Waterloo. En 1911, l'université obtient par une loi sa personnalité juridique et se dénomme Université libre de Bruxelles - Vrije Hogeschool te Brussel[16]. Première Guerre mondialeDe 1914 à 1918, les cours sont suspendus à la suite du sac de Louvain, à l'incendie de la bibliothèque et à la mort de 248 personnes dans la nuit du 25 au , événement qui connut un grand retentissement dans la presse internationale. Il faudra attendre le pour que les cours reprennent à l’université libre de Bruxelles. « Plutôt périr que céder(…) elle manquerait à elle-même si elle acceptait la censure : ce qui caractérise notre institution, ce qui lui donne sa seule ou tout au moins sa vraie grandeur, c’est la liberté de pensée et de parole qui s’est abritée ici »[1]. Voici ce que déclarait Paul Héger, vice-président du conseil d'administration face aux tentatives des forces d’occupation allemandes de soumettre l’enseignement universitaire à ses ordres[17]. Seconde Guerre mondiale Les autorités de l'Université protestent contre les deux ordonnances antijuives du qui furent émises par l'occupant allemand, mais laissent néanmoins leurs services administratifs procéder à une « exécution passive » des ordonnances. L'« exécution passive » aboutit à l'exclusion des professeurs juifs, dont Chaïm Perelman qui organisa le comité de défense des Juifs, et sera suivie par l'exclusion des étudiants juifs. Certains ex-étudiants, s'engagent alors dans l'Association des Juifs en Belgique plutôt que dans la résistance, qui était quant à elle constituée principalement de Juifs issus des milieux populaires et de l'extrême-gauche. Certains rejoignent néanmoins la résistance comme Youra Livchitz, ex-étudiant de la Faculté de Médecine, qui organisa le l'attaque contre le convoi n° 20, contre la déportation raciale des Juifs[18]. En , sous l'occupation allemande, l'université préfère se saborder en fermant ses portes plutôt que d'accepter des professeurs flamands d'Ordre nouveau imposés par les Nazis[19]. Les étudiants et des professeurs partent dans d'autres universités belges, mais certains professeurs donnent des cours clandestins. Des professeurs et des étudiants militent dans la résistance, dont le Groupe G composé d'ingénieurs qui procèdent à des sabotages techniques comme la grande coupure affectant le réseau à haute tension par des destructions de pylônes et de stations électriques, ce qui handicape gravement les industries réquisitionnées par l'Allemagne pour la production de guerre[20]. La libération de Bruxelles, en , permet une reprise progressive des cours. Néerlandais et naissance de la Vrije Universiteit BrusselDes cours furent donnés en néerlandais à l'université libre de Bruxelles dès 1890 en faculté de Droit, et en 1963 dans presque toutes les facultés. En attendant le monde politique ralenti par l'affaire de Louvain, l'université libre de Bruxelles prit les devants et se scinda en en deux administrations distinctes établies selon la langue. En 1970, une loi dissout définitivement la personnalité juridique de l'université libre de Bruxelles - Vrije Universiteit te Brussel. Contrairement à l'université de Louvain, qui ne fut pas dissoute et où les actuelles UCLouvain et KU Leuven se partagent la personnalité juridique de 1911, deux nouvelles universités libres de Bruxelles sont fondées par cette même loi du 28 mai 1970 : l'université libre de Bruxelles, francophone, ainsi que la Vrije Universiteit Brussel néerlandophone[21]. Juridiquement, les deux universités sont donc indépendantes. Cependant, le titre de Vrije Universiteit Brussel est l'exacte traduction du nom de l'université libre de Bruxelles, les valeurs de la philosophie du libre examen étant celles de la nouvelle université de langue néerlandaise, comme elles sont celles de l'université libre de Bruxelles depuis 1835. Les deux institutions sont d'ailleurs voisines, les nouveaux bâtiments de la Vrije Universiteit ayant été érigés sur l'ancien champ de manœuvres de la gendarmerie à côté des extensions de l'université libre sur ce que l'on appelle le Campus de la Plaine, à Ixelles. Mais l'université francophone conserve le siège historique situé non loin de là, avenue Roosevelt, en plus de ses extensions. Cette proximité favorise les contacts entre professeurs dont certains enseignent dans les deux établissements. Des formations et des masters sont d'ailleurs organisés en commun. Faucons pèlerins Depuis le printemps 2019, un couple de Faucons pèlerins s'est naturellement installé au sommet d'un des bâtiments du campus du Solbosch. La femelle est née en 2014 près de Maastricht et le mâle en 2015 sur l'église Notre Dame de Laeken[22]. Cette installation naturelle fait suite à la progression spectaculaire de cette espèce en Belgique depuis que des mesures de protections ont été prises afin de permettre son retour après sa disparition totale du pays et d'une large partie de l'Europe suite à la persécution et à l'emploi de pesticides. Le couple nicheur du Solbosch fait s'élever à 14 le nombre de sites de nidification de cette espèce dans la Région de Bruxelles-Capitale. Campus L'université est principalement implantée sur trois campus :
Le principal est celui du Solbosch, qui accueille l'administration et les services généraux de l'université. On y trouve également la plupart des facultés de sciences humaines, l'École polytechnique, la grande bibliothèque des sciences humaines, et parmi les musées de l'ULB, le musée de zoologie, la salle d'art contemporain Allende et le musée M. De Ghelderode. Le campus de la Plaine accueille la Faculté des sciences et la Faculté de pharmacie. On y trouve aussi les Experimentariums de physique et de chimie, le musée des plantes médicinales et de la pharmacie et des logements étudiants. Le campus Érasme abrite l'hôpital Érasme et le Pôle Santé, c'est-à-dire la Faculté de médecine, l'École de santé publique et la faculté des sciences de la motricité (la faculté de pharmacie se trouvant à la Plaine). S'y trouvent également l'École d'infirmières (avec la Haute école libre de Bruxelles - Ilya Prigogine), le musée de la médecine et le musée d'anatomie et d'embryologie humaines. Le Biopark Charleroi Brussels South, situé sur le site de l'Aéropole de Gosselies (Charleroi) abrite l'Institut de biologie et de médecine moléculaires (IBMM), l'Institut d'immunologie médicale (IMI), le Laboratoire de biotechnologie végétale (LBV), le centre multimodal d'imagerie (CMMI), plusieurs spin-offs, un incubateur (Wallonia Biotech SA) et le premier centre intégré de vaccinologie en Région wallonne : ImmuneHealth. Transport en commun
Facultés, instituts et écolesCliquez sur dérouler pour voir la liste des facultés, instituts et écoles
Dépend également de l'université libre de Bruxelles :
 Musées de l’université libre de BruxellesLe Réseau des musées de l’ULB fédère 12 musées de l’université, répartis sur 4 campus bruxellois (Auderghem, Érasme, Plaine, Solbosch) et 2 sites wallons (Charleroi-Parentville, Treignes). À ces 12 musées, il faut ajouter des collections universitaires non ou difficilement accessibles au public (cartothèque géographique, instruments électriques anciens, moulages en plâtre, numismatique, etc.).
Réseau des musées de l’ULBSi chacun de ces 12 musées est le résultat d’une histoire particulière parfois ancienne, le Réseau des musées de l’ULB est une association de fait née en [26]. L’objectif de cette opération était de permettre aux acteurs impliqués dans les diverses initiatives muséales de l’université de mieux se connaître et de découvrir les réalisations de chacun d’entre eux. La création d’un réseau des musées de l’ULB est outil de renouvellement de la pédagogie et lieu d’apprentissage. Depuis lors, ces 12 musées se rencontrent mensuellement et ont établi ou réalisent des projets communs, comme un site internet et les Dimanches des musées de l’ULB. La motivation qui sous-tend les projets du Réseau est le désir de faire rencontrer au public deux types d’institutions aux visages très proches : le musée et l’université. En effet, outils de recherche et de progrès et gardiens du patrimoine, musée et université sont aussi les conciliateurs de l’art et de la science, domaines trop souvent considérés comme antagonistes. Les Dimanches des musées de l’ULB constituent la première concrétisation de ce souhait de voir collaborer ces deux acteurs des scènes culturelles, scientifiques et pédagogiques, dans le but de partager avec le public leurs connaissances et leurs acquis. En tant qu’association de fait, le Réseau adhère à diverses associations de musées, nationales et internationales, tels le Conseil bruxellois des musées (CBM), l’Association francophone des musées de Belgique (AFMB) ou encore le Comité international pour les musées universitaire (UMAC) de l’ICOM. Partenaires privilégiésLes autorités académiques ont désigné comme « partenaires privilégiés » un nombre restreint d'institutions étrangères. Ce choix est basé, d’une part, sur le nombre et la qualité des relations scientifiques et d’enseignement avec ces institutions et, d’autre part, sur les orientations stratégiques internationales de l’ULB. Il permet notamment de faciliter le développement de nouvelles collaborations scientifiques avec ces institutions et d’en inviter des collègues dans le cadre de chaires internationales.
Prix et récompensesNobel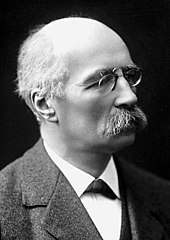 L'université libre de Bruxelles a vu six de ses diplômés ou professeurs récompensés par le prix Nobel.
Prix WolfPrix Francqui
Médaille Fields Une médaille Fields a été décernée à Pierre Deligne en 1978. Prix AbelUn prix Abel a été décerné à Jacques Tits en 2008 et à Pierre Deligne en 2013. Personnalités liées à l'ULBRecteursEnseignants et chercheurs Dès sa fondation, l'université dispose des plus éminents professeurs de l'époque : Auguste Baron, Van de Weyer, Quetelet, Waxweiler. L'aéronaute et océanaute suisse Auguste Piccard, comme les physiciens Robert Brout et François Englert (ULB 1959, prix Nobel de physique) donnèrent aussi des cours à l'université. Les enseignants occupent l'une des catégories d'emplois suivantes : professeur (définit les enseignements et assure les cours magistraux), professeur associé (assure les cours d'approfondissement), professeur chargé de cours (assure les cours d'application), maître de conférences (encadre des groupes d'élèves et anime des séminaires) ou chargé d'enseignement (encadre les travaux pratiques, expérimentaux ou informatiques). Liste
Liste des premiers professeurs de l'université libre de Bruxelles avant 1884En 1884, après cinquante ans d'existence, l'université publia un premier bilan[28] de ses activités et la biographie des professeurs qui, en un demi-siècle, ont fondé son enseignement.
ÉtudiantsListe
Docteur honoris causaL'université libre de Bruxelles honore également des personnalités de renom pour leurs activités diverses en les nommant docteurs honoris causa. Ne sont repris ci-dessous que les docteurs nommés par l'université et non ceux nommés par les facultés. Par ailleurs, la liste ne remonte pas plus loin que 1973, première année de remise du titre après la scission linguistique.
Folklore estudiantinCerclesAssociation des Cercles ÉtudiantsVoici une liste de certains cercles membres de l'Association des Cercles Étudiants avec leur année de fondation (ndla : et non pas d'intégration dans l'Association des Cercles Étudiants) :
Chanson estudiantineL'expression la plus ancienne et la plus raffinée du folklore estudiantin est la chanson estudiantine ou paillarde. Certaines datent du 19e siècle. Parmi ces chants, il en est de traditionnels et d'autres caractéristiques de leur époque. L'histoire de la chanson estudiantine de ce dernier demi-siècle à l'ULB est marquée par deux événements majeurs. D'abord, en 1975, la création du festival de la chanson estudiantine qui imposa la création de chansons originales et renouvela et enrichit le répertoire. Ensuite le développement de guildes qui par leurs cérémonies et cantus maintiennent vivant ce patrimoine. Le recueil des chants pratiqués à l'ULB se retrouve dans les Fleurs du Mâle. La première édition, œuvre du Cercle des Sciences, date de 1922. Depuis de longues années, l'Union des Anciens Étudiants en assure les rééditions. Festival de la chanson estudiantineLe Festival belge de la chanson estudiantine[30] est organisé chaque année, depuis 1975, au début du mois de novembre par le Cercle Polytechnique dans l’auditoire Janson méconnaissable. Il s’agit d’un concours de création et d’interprétation de chansons qui se fait par équipes de 4 à 6 chanteurs. Ce festival vise à promouvoir cet art qu’est le chant estudiantin et à en renouveler son répertoire. Lors du Festival, un jury remet une série de prix aux meilleurs groupes. Celui-ci ne se limite pas à l’ULB. En effet, le concours accueille chaque année des groupes venant d’universités et hautes écoles diverses en Belgique. Le Festival, ayant pour mission d’initier le plus grand nombre de personnes à la chanson estudiantine, est ouvert à tout le monde. GuildesLes Guildes de l’ULB ont vu le jour à partir des années ‘80 par l’intermédiaire de quelques étudiants soucieux de remettre le chant étudiant au goût du jour de façon plus formelle que cela ne se réalisait jusque-là. En effet, au fil du temps, son intérêt et surtout sa présence déclinèrent. Seul le Festival belge de la chanson estudiantine maintenait encore ce folklore visible et vivace. Pour ces raisons et bien d’autres, des groupes de jeunes et d’anciens étudiants, voulurent rétablir ces traditions en perdition. Par cette volonté et un large héritage de traditions folkloriques, naquirent les guildes tels que nous les connaissons aujourd’hui. Généralement, une Guilde est composée de plusieurs membres ayant des postes définis, ceux-ci organisent au moins un évènement par mois, il peut s’agir de cantus classiques ou à thèmes, aussi bien que de vadrouilles (ndla : il s’agit d’une tournée des bars au cours de laquelle les participants chantent et célèbrent la camaraderie) ou de sorties culturelles. La Guilde a généralement à sa tête un Senior, qui s’assure d’orchestrer tout cela dans une ambiance fraternelle et conviviale. Le Senior est accompagné dans son bureau par le Cantor, qui se charge de lancer et proposer les chants, du Censor faisant respecter le calme et l’autorité à grands coups de bière ou punitions aussi dérisoires qu’amusantes, du Quaestor responsable des finances, du Scriba faisant office de secrétaire, et du Fuchs Mayor gérant les fuchsen (ceux qui servent les boissons) et les fûts. Chaque Guilde ou groupe possède un décorum propre lors de ses cantus. Mais tous partagent l’utilisation de la Corona (où les tables sont disposées en U), l’éclairage à la lueur des bougies et bien entendu la bière. Voici une liste des principales guildes de l'ULB avec leur année de fondation :
OrdresVoici une liste de certains ordres reconnus ou parodiques avec ou sans leur année de fondation :
ControversesConflit suite à la guerre Israël-Hamas entre les étudiants et la direction de l'université libre de Bruxelles en 2024Contexte et prémices du conflitEn répercussion à la guerre Israël-Hamas, débutée le 7 octobre 2023, et notamment aux bombardements israéliens dans la bande de Gaza, un conflit sur la position et les initiatives exactes à adopter vis à vis de ces évènements par l'université libre de Bruxelles éclate entre la direction de l'établissement, à la tête de laquelle se trouve la rectrice Annemie Schaus, et une partie de ses étudiants, qui appellent à un soutien plus marqué des Palestiniens et au boycott d'Israël. Le 18 décembre 2023, un communiqué du conseil des recteurs francophones sur la situation au Proche-Orient est ainsi publié sur le site internet de l'université libre de Bruxelles dans lequel le conseil se déclare « profondément inquiet de l'intensification des violences au Proche-Orient ainsi que des mouvements communautaristes qui en découlent sur les campus universitaires » et s'engage à « suspendre les collaborations institutionnelles avec les organisations, quelle que soit leur origine, qui soutiennent de manière répétée ou sont directement impliquées dans les violations du droit international et des droits humains »[31], l'université rompant effectivement une convention structurelle pour un échange d'étudiants avec l'Université de Tel Aviv selon Annemie Schaus[32]. Le 26 avril 2024, une conférence de l'avocat franco-palestinien Salah Hammouri, condamné en Israël pour des faits de terrorisme, organisée à l'université libre de Bruxelles par l'association des Ambassadeurs d'Expression citoyenne, l'Association belgo-palestinienne, le Cercle des Étudiants Arabo-Européens et Boycott-Désinvestissement-Sanctions ULB, fait polémique. En effet, sa présence sur le campus est dénoncée par l'Union des Étudiants Juifs de Belgique car favorisant selon eux la crispation entre communautés et par Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, qui considère l'intervenant comme un « terroriste franco-palestinien » membre du Front populaire de libération de la Palestine et qui affirme que l'affiche de l'événement, représentant une carte de la Palestine historique, de la mer Méditerranée au Jourdain, « reprend un logo rayant Israël de la carte de leur Palestine ». Selon les organisateurs de la rencontre, la direction de l'ULB les contacte plusieurs fois en réaction, pour leur demander de changer le visuel de l'évènement qui nierait selon elle le « droit d'autodétermination du peuple juif », sous peine d'interdire la conférence. Finalement, l'établissement maintient la rencontre et annonce l'organisation, prévue le 3 juin 2024, de « débats rassemblant un panel d'experts du Proche-Orient, dans une perspective équilibrée et raisonnable, visant à susciter le dialogue plutôt que de crisper les positions »[33],[34],[35],[36],[37]. Occupation étudiante d'un bâtiment du campus du SolboschÀ partir du 7 mai 2024[38],[39],[40], une centaine d'étudiants investissent en signe de soutien aux Palestiniens le bâtiment B du campus du Solbosch, qu'ils rebaptisent bâtiment Walid Daqqa[41] en l'honneur d'un activiste et prisonnier palestinien mort en détention le 7 avril 2024. Le groupe, dont les dirigeants gardent l'anonymat[42], prend le nom d'« Université populaire de Bruxelles ». Selon le Parti Socialiste de Lutte, son projet d'occupation dérive d'échanges sur les réseaux sociaux entre des étudiants américains et européens[43]. Il est soutenu par d'autres associations bruxelloises et par certains professeurs de l'ULB[44]. S'inscrivant dans le mouvement étudiant propalestinien en 2024, dénonçant un « génocide » en cours dans la bande de Gaza, il a pour principale revendication la fin de tout partenariat de l'institution avec des universités israéliennes, considérées comme des « institutions académiques et entreprises sionistes qui participent à l'oppression systématique du peuple palestinien »[40], notamment l'arrêt de projets de recherche en lien avec l'Institut de technologie d'Israël, l'Institut Weizmann des Sciences et l'Université hébraïque de Jérusalem[39],[32]. La rectrice Annemie Schaus refuse, argumentant que l'ULB a déjà pris des initiatives en faveur des Palestiniens et que les collaborations universitaires décriées sont des conventions entre professeurs des différentes institutions citées[32]. Les étudiants s'opposent également, dans leur communiqué du 8 mai 2024[45], à la venue à l'ULB, prévue le 3 juin 2024, du diplomate et intellectuel israélien Élie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France réputé favorable à la création d'un État palestinien indépendant, critiquant ses propos du 15 octobre 2023 dans un entretien à France Info selon lesquels : « La chose la plus simple, c’est de soumettre Gaza à un tapis de bombes sans se poser de questions »[46],[47],[48]. Annemie Schaus, qui l'avait convié à participer à l'échange sur l'avenir au Proche-Orient annoncé en avril, refuse l'annulation de la visite et déclare à ce sujet : « Je ne céderai pas, ni aux intimidations, ni aux pressions, ni aux menaces »[38]. Le 15 mai 2024, des professeurs de l'ULB dénoncent dans une tribune les revendications de l'université populaire de Bruxelles, qu'ils jugent s'inscrire dans l'antisionisme radical de gauche dont certains des aspects seraient antisémites, et une condamnation trop faible du mouvement étudiant comme de l'antisémitisme de la part de la direction[49]. Le 23 mai 2024, lors d'une réunion avec l'université populaire de Bruxelles proposée par celle-ci, Annemie Schaus et le vice-recteur Marius Gilbert acceptent de supprimer du site de l'ULB les offres de stages de l’entreprise française Thales, accusée de vendre des armes à Israël, mais rejettent la suspension des collaborations entre l'université belge et celles d'Israël. Marius Gilbert soutient que ces projets de recherches sont financés par l'Union européenne et que l'ULB perdrait des fonds en cas de retrait[39]. L'occupation de l'édifice du campus du Solboch par l'université populaire de Bruxelles se poursuit[48]. Le 3 juin 2024, plusieurs centaines d'étudiants manifestent sur le campus du Solbosh pour protester contre la participation d’Élie Barnavi à une conférence-débat organisée le jour même par l'ULB au centre culturel du Flagey, avant de tenter de s'y rendre sans pouvoir y parvenir, les rues avoisinantes étant bloquées par la police[48]. Le 17 juin 2024, Annemie Schaus adresse après un conseil académique un email à l'ensemble de la communauté universitaire où elle appelle l'université populaire de Bruxelles à quitter dans les plus bref délais le bâtiment qu'elle occupe, estimant que la manière dont le mouvement étudiant a évolué « ne répond plus aux idéaux qui l'ont motivé », déplorant des « dégradations commises » lors des actions menées et reprochant au collectif un manque de communication[40]. Devant leur refus, exprimé le 21 juin, la police belge expulse de force les étudiants de l'édifice le 25 juin 2024 à six heures du matin, selon des vidéos diffusées par les personnes sur place sur les réseaux sociaux, bien que la direction de l'ULB affirme dans un communiqué de presse que « La police présente sur place n’est pas intervenue, les occupants ayant quitté les lieux sans heurts »[50]. Poursuite du conflit et développement pénalEn septembre 2024, le parquet de Bruxelles indique que plusieurs personnes, dont des étudiants membres de l'université populaire de Bruxelles, sont visées par des plaintes déposées notamment pour des faits « d'appartenance à un groupe promouvant la haine et la ségrégation raciale »[51]. L'université populaire de Bruxelles, basée à Saint-Gilles[52], poursuit ses activités après la fin de l’occupation. Le 13 novembre 2024 à partir de 18h, ses membres participent avec d’autres mouvements considérés comme de gauche radicale, comme la Coordination antifasciste de Belgique, la coalition Stand-Up et le Réseau ADES, à des manifestations devant la Maison de Hongrie contre la présence à Bruxelles de l'homme politique français Jordan Bardella, président du parti du Rassemblement national, venu y dédicacer son livre Ce que je cherche. Au cours de ces protestations, des manifestants tentent de forcer le barrage policier barrant l'accès au bâtiment mais sont repoussés par la police, qui fait usage sur eux de matraques, de gaz lacrymogène et de jets d'eau sous haute pression[52],[53]. Le week-end qui suit, l'université populaire de Bruxelles publie sur son compte Instagram, au sujet des attaques commises contre des supporters israéliens après un match de football à Amsterdam dans la nuit du 7 au 8 novembre 2024[54] : « Pas de sionistes dans mon quartier, pas de quartier pour les sionistes », ajoutant que « les sionistes ne sont pas les bienvenu.es dans les rues de l'Europe entière ». Dans un post publié sur Facebook, Annemie Schaus dénonce un « antisémitisme virulent grossièrement maquillé derrière le cache-sexe de l'antisionisme »[52]. Selon elle, ces propos représentent « un appel intolérable à la violence contre les Juifs » et « pas de quartier ne signifie rien d'autre que "tuez-les" ». L'université populaire de Bruxelles réagit à cette prise de position en dénonçant une « instrumentalisation » de la lutte contre l'antisémitisme « au service de la propagande israélienne », une « répression d'un mouvement de solidarité envers la Palestine » et affirme que « Le véritable enjeu ici ne concerne pas l'antisémitisme, mais bien la censure et la répression »[55]. Le 10 novembre 2024, l'institut Jonathas, centre d’études et d’action contre l'antisémitisme en Belgique, porte plainte contre l'université populaire de Bruxelles pour incitation à la haine et à la violence en raison du contenu du post Instagram controversé[42],[55],[52]. Suite à un conseil académique tenu le 21 novembre 2024, la direction de l'ULB annonce le 9 décembre 2024 suspendre tout accord et projet institutionnel de recherche impliquant une université israélienne jusqu'à « l'engagement clair » des institutions concernées « en faveur des exigences émises par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 24 mai » et s'engage à établir des partenariats avec les universités palestiniennes. Cette décision est perçue par la presse comme une victoire pour le mouvement étudiant[56],[57]. Cependant, l'université populaire de Bruxelles déclare : « Nous continuons à porter toutes nos revendications. La transparence totale sur les partenariats de l'ULB, […] et surtout que cette suspension évolue vers un boycott complet des universités et entités complices de la colonisation en Palestine »[56]. Le même jour du 9 décembre 2024, une vingtaine de cercles étudiants de l'ULB, dont l'université populaire de Bruxelles[58], s'opposent et appellent à protester contre la venue à l'université de l'homme politique belge Georges-Louis Bouchez, visé par une plainte pour apologie de crimes de guerre et président du parti du Mouvement réformateur, et de l'essayiste franco-américain Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui figurent parmi les invités à une conférence sur le campus du Solbosch consacrée à l'impact économique et militaire de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024, organisée par le Centre de réflexion libéral Jean Gol. Les étudiants demandent à ce qu'il n'y ait « Pas de fachos sur notre campus », estiment que « L'ULB, notre université, trahit ses valeurs en accueillant des figures qui légitiment des crimes de guerre et propagent des discours de haine » et critiquent les déclarations de Georges-Louis Bouchez, qui avait qualifié le 24 septembre 2024 sur Radio Judaica les explosions de bipeurs et de talkies-walkies au Liban de « coup de génie » de la part d'Israël, et celles de Louis Sarkozy du 26 septembre 2024 sur LCI qui avait déclaré, commentant la riposte militaire d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah : « Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis : qu’ils crèvent. Israël fait le travail de l’humanité ici. Absolument, aucun remord à ce niveau-là, qu’ils crèvent tous »[58],[59]. Environ deux cents manifestants tentent d'empêcher l'accès à la conférence, ce qui conduit à l'intervention de la police, qui arrête suite à des jets de projectile quatre personnes, qui sont mises en détention administrative avant d'être relâchées[60],[61],[62],[58]. Par la voix d'Annemie Schaus, la direction de l'ULB dit déplorer la situation et condamner le recours à la violence[58]. La politique menée par Annemie Schaus depuis le début du conflit est cependant critiquée, étant jugée répressive envers les étudiants pro-palestiniens par leurs partisans[56],[63]. Notes et référencesNotes
Références
Voir aussiBibliographie
Articles connexes
Liens externes
Information related to Université libre de Bruxelles |